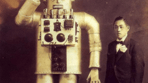La quinzaine du Journal éclaté
Lettre intermédiaire et entièrement publique, avec lectures du moment.


Récapitulatif de la première quinzaine sur le Journal éclaté :
Ma lecture du roman de la rentrée, Bruits, lu aussi par Pierre Ménard et Christine Jeanney, La Viduité et Le Monde des livres. 6 janvier.
Reposante neige : Sourires dans la neige, ralentissements... 8 janvier.
Ça reste une année neuve : Comme un bilan. L’une, l’autre. S’est-elle bien terminée ? Commence-t-elle bien ? 12 janvier.
Suprême-gauche : Version éclatée d’un texte fluide. Je crois. 15 janvier.
Du côté de L’aiR Nu, l’infolettre numéro 28 est parti le 15, si vous n’êtes pas abonné, c’est toujours gratuit, mensuel, sonore et par ici.
Concernant les livres lus ou en cours de lecture :
Platon, La République. Recueil de conversations sur le quotidien de la pensée, traduction de Robert Baccou.
Andreï Kourkov, Notre guerre quotidienne. Recueil d’articles sur le quotidien en Ukraine, traduction de Johann Bihr.
Colette, Sido et Les Vrilles de la vigne. Recueil de souvenirs sur le quotidien de l’enfance, du passé.
Claire Fourier, Tout est solitude. Recueil de pensée sur le quotidien de la solitude. Extrait en écoute dans L’aiR Lu.
Andreï Kourkov :
Nous nous sommes déjà faits à l’idée que la guerre puisse mettre à la rue des animaux de compagnie, mais il faut désormais s’habituer à ce que des dizaines de milliers de colonies d’abeilles subissent le même sort dans le Donbass et dans le sud de l’Ukraine. D’ordinaire, quand une ruche est endommagée par un bombardement, les abeilles « retournent » à la nature et deviennent sauvages. L’essaim se déplace d’un endroit à l’autre, se posant dans les arbres ou sur des murs en ruine, jusqu’à trouver un endroit plus pérenne, comme le creux d’un vieil arbre ou le grenier d’une maison abandonnée. Tout en cherchant un nouveau foyer, les abeilles s’efforcent aussi de s’éloigner du bruit et de la destruction causés par la guerre. Elles fuient, non seulement parce qu’il n’est pas très agréable de butiner du pollen qui sent la poudre à canon, mais surtout parce qu’elles aiment le silence, un silence dans lequel elles peuvent s’entendre bourdonner.
Colette :
À trois heures et demie, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus, et quand je descendais le chemin de sable, le brouillard retenu par son poids baignait d’abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait, atteignait mes lèvres, mes oreilles et mes narines plus sensibles que tout le reste de mon corps… J’allais seule, ce pays mal pensant était sans dangers. C’est sur ce chemin, c’est à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d’un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion…
Ma mère me laissait partir, après m’avoir nommée “Beauté, Joyau-tout-en-or” ; elle regardait courir et décroître sur la pente son œuvre, – “chef-d’œuvre”, disait-elle. J’étais peut-être jolie ; ma mère et mes portraits de ce temps-là ne sont pas toujours d’accord… Je l’étais à cause de mon âge et du lever du jour, à cause des yeux bleus assombris par la verdure, des cheveux blonds qui ne seraient lissés qu’à mon retour, et de ma supériorité d’enfant éveillée sur les autres enfants endormis.
Je revenais à la cloche de la première messe. Mais pas avant d’avoir mangé mon saoul, pas avant d’avoir, dans les bois, décrit un grand circuit de chien qui chasse seul, et goûté l’eau de deux sources perdues, que je révérais. L’une se haussait hors de la terre par une convulsion cristalline, une sorte de sanglot, et traçait elle-même son lit sableux. Elle se décourageait aussitôt née et replongeait sous la terre. L’autre source, presque invisible, froissait l’herbe comme un serpent, s’étalait secrète au centre d’un pré où des narcisses, fleuris en ronde, attestaient seuls sa présence. La première avait goût de feuille de chêne, la seconde de fer et de tige de jacinthe… Rien qu’à parler d’elles je souhaite que leur saveur m’emplisse la bouche au moment de tout finir, et que j’emporte, avec moi, cette gorgée imaginaire…
Entre les points cardinaux auxquels ma mère dédiait des appels directs, des répliques qui ressemblaient, ouïes du salon, à de brefs soliloques inspirés, et les manifestations, généralement botaniques, de sa courtoisie ; – entre Cèbe et la rue des Vignes, entre la mère Adolphe et Me de Fourolles, une zone de points collatéraux, moins précise et moins proche, prenait contact avec nous par des sons et des signaux étouffés. Mon imagination, mon orgueil enfantins situaient notre maison au centre d’une rose de jardins, de vents, de rayons, dont aucun secteur n’échappait tout à fait à l’influence de ma mère.
Bien que ma liberté, à toute heure, dépendît d’une escalade facile – une grille, un mur, un “toiton” incliné – l’illusion et la foi me revenaient dès que j’atterrissais, au retour, sur le gravier du jardin. Car, après la question : “D’où viens-tu ?…” et le rituel froncement de sourcils, ma mère reprenait son tranquille, son glorieux visage de jardin, beaucoup plus beau que son soucieux visage de maison.
La prochaine lettre sera réservée aux abonné·es, le 3 ou le 4 février, oups, il faut que je m’y mette !
...