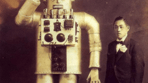Mars 1917
En ce jour d'armistice, un extrait inédit du Réseau Robert Keller.


Mars 1917
Dans la salle de travaux pratiques du lycée, Robert Keller assemble un mille-feuille de fines plaques de cuivre alternant avec du papier paraffiné. Il fixe le tremblement de ses doigts pour bien placer les uns par-dessus les autres ces quelques centimètres carrés de condensateur artisanal.
Il va avoir 18 ans dans deux mois. Au lycée, depuis quelques semaines, il a revu les principes de base de l’électricité et, à la maison, a ressorti ses vieux circuits. Désormais, il connaît la théorie, les lois. Il s’est aussi intéressé, dans le même temps, au progrès de la guerre, ce qu’elle déploie par nécessité. Radio, réseau télégraphique et téléphonique, moteurs électriques. La guerre moderne peut installer un monde nouveau, dès demain. La guerre apporte la fin de la guerre et le progrès, rien ne lui semble inutile, même quand c’est inutile. Robert préfère regarder ce qui stimule son imagination, plutôt que ce qui fait mal. En ne regardant pas les balles qui s’échangent, il finit par ne plus voir que la technologie qui s’installe.
Robert respire et fixe les pinces crocodile du circuit à son assemblage, et branche l’ohmmètre. Il note les résultats, se rêve sous une tente de l’armée où il pourrait réparer un poste à galène.
Le soir, au dîner, il formule son désir. La motivation est double, puisque devancer l’appel de quelques mois lui permettra de choisir son unité, son arme, et ce sera l’électricité. Avant de se lancer, en mangeant sa soupe, Robert regarde, sur le buffet, la bible de sa mère, celle du grand-père Strub. Elle est rarement ouverte, c’est un objet de mémoire. Le signet tricolore est éternellement placé à une page de l’Exode, peut-être : « Tu n’opprimeras point l’étranger ; vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte. » Ses grands-parents avaient choisi sans la choisir la France en quittant leur village natal. Ils auraient pu aller en Algérie, à Paris, en Bretagne. Peu de familles ont fini en Normandie, mais c’est là que les Keller et les Strub se sont rencontrés, et où Robert est né, deux ans après sa sœur Henriette. Une petite famille, pour l’époque, resserrée. Tout autour, il y a le patriotisme, la notion de défendre le drapeau. Et cette ligne familiale, pour eux, d’avoir choisi la France, quarante ans plus tôt, d’être Normand et de parler alsacien, et un désir, une croyance au pouvoir d’arrêter la guerre en y allant, pour agir.
En parlant, il sait que son âge fait que son père doit signer, accepter d’envoyer son fils prématurément dans une guerre qui n’est pas terminée, qui pourrait durer encore vingt, trente ans, ou quelques jours. La mère ne dit rien, devancer sert à le protéger, mais c’est quand même la guerre. Elle est prise entre l’histoire de sa famille, la vie de son fils, et la question de savoir ce que c’est la guerre, contre laquelle tout le monde se cogne. C’est une famille comme ça, qui vient de 1870, exilée pour fuir un Empire qui menace de les poursuivre. En 17, un Alsacien peut n’avoir jamais quitté son village, et être passé par quatre changements de son drapeau et de l’uniforme militaire. Les Keller ont le tricolore comme totem, c’est l’ambiance de l’époque, l’esprit de revanche flotte aussi. L’engagement peut être un déclic, un instant infime où l’on passe de fils et petit-fils d’exilés alsaciens à l’évidence d’être « patriote français », facilité par les avantages promis par le devancement. La morale peut être fléchie.
Pour les parents, il y a l’évidence de ce trajet, et le refus que leur fils devienne soldat, parce qu’on ne devrait pas tuer les enfants. Robert les rassure, attendre c’est devenir soldat, partir maintenant, c’est être électricien. Participer à la technologie de la guerre, c’est ce qu’il sait faire et qui est nouveau, inconnu, l’avantage sur l’ennemi, la guerre contemporaine se joue désormais dans les fils électriques, plus dans les tranchées. Un électricien ne va pas au combat, et après la victoire, il sortira formé.
La nuit du 20 mars, les Keller dorment très mal. Robert se remet à douter, puis se décide définitivement, comme sortant d’un rêve de courant alternatif alimentant un faisceau de licteur. Ils discutent à nouveau une bonne partie de la matinée. Le risque, le refus du risque, l’assurance d’être planqué, et l’armée fournit une place, une situation durable, pour la suite. Si l’on survit. En Normandie on est assez tranquille, le front est loin. C’est un destin que Robert Keller se forge, qu’il veut se forger.
On sait les balles de fusils, les trous d’obus et l’aviation nouvelle, d’abord observatrice puis équipée de mitrailleuses. L’horreur, bien sûr, que les avancées scientifiques soient ainsi utilisées, mais la force de la propagande d’utiliser les « as » pour montrer le génie technologique comme moyen de gagner est bien là. On n’a plus de mots. D’ailleurs, dans la presse, oui, plus de mots : la censure transforme le nombre des morts en « morts officiels », et leur qualité de cadavres de jeunes garçons en « tombés glorieusement pour la France ». On parle de gaz, on voit les gueules cassées qui reviennent, on sait les enlisements qui tournent au massacre, sous forme de rumeurs, on sait les morts, car on voit bien qui revient, qui ne revient pas, qui continue d’écrire, et qui cesse, jusqu’au courrier officiel.
Robert Keller s’informe avec ce qu’il entend, ce qu’il trouve dans les journaux qui traînent chez lui, chez les amis ou au café. Il voit ce qui se joue, à des milliers de kilomètres, dans le tissu des influences, des rapports de force, ça le dépasse probablement comme ça dépasse beaucoup de monde. Le petit Keller a en tête non pas une idée claire et nette, mais une urgence à agir, pour lui, ce sont les gestes qui font le monde, pas les idées. La question de la peur ne s’impose pas à lui. Il n’a pas l’expérience du nez dans la boue, avec les balles en huant qui tracent des fils de fer dans l’air à vos oreilles, et les barbelés qui emprisonnent jusqu’aux Balkans, au Mozambique, à l’Océanie. Il devine que le monde vit par la guerre depuis toujours, et il n’y peut rien. Une usine dont il peut sentir la fumée en ouvrant sa fenêtre fabrique un obus qui éclatera à Bagdad. Dans son atlas illustré, il joue à la carte d’état-major, manipulée comme un plateau de jeu d’échecs ou de Go. Il place son doigt sur les mines de diamant et d’or. Il désigne les soldats russes qui enroulent un tissu qui n’est plus blanc autour de leurs pieds gelés, il ne lit pas que les grèves se déclenchent à Petrograd, ni que la fraternisation se produit parfois sur certaines lignes de front enlisées. En France, le Premier ministre est aussi Ministre de la Guerre. Que pense, dans cette toile poisseuse, un adolescent qui se veut adulte, qui parle à sa famille, à ses amis ? Arrêter ça, restaurer le pays où il a grandi et qui était à la fois en paix, et en progrès. Voir dans la colonisation un progrès également, sans se mettre à la place des populations indigènes, car c’est le point de vue de la presse et il s’y glisse, il y croit, autour de lui tout le monde y croit. Sans autre raison, arrêter la guerre en la faisant, car, par exemple, le sabotage est hors de question, ne traverse pas son esprit qu’il cherche à former à la rigueur, à la droiture, précis comme un voltmètre.
Le matin, Robert Keller se rend à la mairie. Son père l’accompagne pour l’autorisation. Il va voir le monde, au moins la France. Un garçon intelligent comme ça, on ne l’envoie pas au front, on le garde à fabriquer des systèmes, des mécanismes, ils vont le protéger parce que ça ne court pas les rues. Et puis il ne peut plus y en avoir pour longtemps, il n’y en a jamais pour très longtemps, et puis ils vont le former, il fera une belle carrière et il faut bien la commencer, c’est le moment. Le père se redit ça en boucle comme ils se le disaient, la nuit, avec la mère. On donne un rendez-vous médical, Robert passe les questionnaires, les examens, puis attend quelques jours avant de signer son contrat d’engagement volontaire. L’administration de l’armée l’affecte à Cherbourg. Devancer ne permet cependant pas d’éviter de courir, marcher avec sac et équipement, démonter et remonter un fusil, ramper, sauter, courir encore et obéir, obéir surtout.
Pendant quatre semaines. Puis, un midi, un sergent vient voir Robert à la cantine, pour l’emmener dans un hangar où il y a des appareillages électriques montés sur des planches de bois verticales : interrupteurs, grilles d’ampoules, disjoncteurs, générateurs… Au dépôt des Équipages et de la Flotte, un bureau, des étagères remplies de livres, cahiers, classeurs. On lui demande de monter un circuit avec un générateur, deux ampoules, deux interrupteurs, du fil et des pinces crocodiles, un tournevis, de manière à ce qu’allumer une ampoule éteigne l’autre et réciproquement. Robert réalise ce circuit simplissime en quelques minutes. Il arrête de courir dans la boue par le froid matinal, pour obéir à d’autres ordres. On l’affecte au port du Havre, où il va mettre en œuvre et approfondir ses connaissances et sa pratique. Il rentre deux jours chez ses parents, qui se félicitent que le plan a fonctionné. Ensuite, il monte sur un chalutier, réquisitionné et mouillé là, transformé en dragueur de mines. Il observe le réseau de fils qui court de la passerelle aux ponts, à la salle des machines, et ceux qui permettent de prévenir en cas d’urgence, d’incendie, ceux qui déclenchent les alarmes, les évacuations. Il représente l’ensemble sur un dessin aux normes. On lui montre aussi le poste radio, on lui indique des notions de goniométrie qui aident à localiser la provenance d’un signal radio par triangulation géographique, l’avantage sur l’adversaire et le risque pour soi que ça représente, stratégiquement.
Robert Keller ne pense pas à la guerre. Il répare des circuits, découvre des montages. Il fait presque partie de l’équipage, le bateau part, mais il reste au port, dans le hangar. Il commence à enseigner à d’aussi jeunes et de plus vieux que lui. Il devient Électricien première classe.
Et puis, au bout d’un moment, cette guerre-là s’arrête.
...